-- Appel à candidatures de la Fondation pour les sciences sociales sur le thème : Le travail à distance. Clôture de l'appel : 15 juillet 2021 à minuit.
L'appel s'adresse aux enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes les disciplines des sciences sociales ayant soutenu leur thèse de doctorat depuis 10 ans au plus.
Le Prix est ouvert à toutes les personnes ayant soutenu leur mémoire de master 2 en 2020 en lien avec l’actualité de la sécurité intérieure et de la justice en France.
Fil info de La Mission de Recherche Droit & Justice
- 12 septembre 2025MRSEI 2026 : l’ANR recrute une présidente ou un président de comité d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un appel à candidatures pour renouveler la présidence du comité d’évaluation scientifique du programme Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’appel MRSEI 2026, un poste est ouvert jusqu’au 05 octobre 2025.
- 12 septembre 2025AAPG 2026 : l’ANR recrute 1 président ou présidente de comité d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un nouvel appel à candidatures pour renouveler les présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifique de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’AAPG 2026, 1 nouveau poste est ouvert jusqu’au 30 septembre 2025.
- 8 septembre 2025Choose France for Science - Appel à manifestation d’intérêt - 2025Ce programme de chaires d’excellence à destination des chercheuses et chercheurs et ingénieurs de très haut niveau exerçant leurs activités à l’étranger a ainsi pour objectif d’offrir à des chercheuses et chercheurs de premier plan des financements pour mener en France de nouveaux projets d’envergure sur une durée de 3 ans. Ces chaires seront ouvertes uniquement à des chercheurs exerçant à l’étranger désirant venir créer une équipe ou rejoindre une structure en France. Elles permettront le développement de leurs programmes de recherche et seront un levier pour candidater aux appels d’offres européens d’envergure. Dans ce cadre, les universités, les écoles et les organismes de recherche identifient des chercheurs internationaux prêts à venir s’installer en Europe. Les chercheurs identifiés sont invités à construire, avec l’institution d’accueil, un projet de recherche, en particulier en lien avec les thématiques suivantes :
- La recherche en santé
- Le climat, la biodiversité et les sociétés durables
- Le numérique et l’intelligence artificielle
- Les études spatiales
- L’agriculture, l’alimentation durable, les forêts et les ressources naturelles
- Les énergies décarbonées
- Les composants, les systèmes et les infrastructures numériques
- 4 septembre 20254 des 9 lauréats français de l’ERC STG 2025 en SHS ont bénéficié du dispositif « Access ERC » de l’ANRLe 4 septembre 2025, le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié la liste des lauréats de son appel Starting Grants 2025. 4 des 9 lauréats français dans le domaine des Sciences humaines et sociales (SHS) ont été bénéficiaires d’un financement « Access ERC » de l’Agence nationale de la recherche (ANR). L’occasion de mettre en lumière ce programme récent, ouvert spécifiquement aux disciplines des SHS, qui accompagne de jeunes chercheurs et chercheuses dans la préparation d’une candidature à l’ERC.
- 4 septembre 2025L’Agence nationale de la recherche (ANR) réorganise sa Direction générale déléguée à la science et crée une Direction de la recherche partenarialeDirigée par Thibault Cantat, la Direction générale déléguée à la science (DGDS) a pour ambition de renforcer les transversalités et la capacité à porter des visions scientifiques d’avenir.
- 28 août 2025Matinée de tables rondes et d’échanges autour de l’appel Flash SIOMRILe 23 septembre à Rouen, la Région Normandie, la Région Hauts-de-France et l'Agence nationale de la recherche (ANR) organisent une matinée de tables rondes et d’échanges autour de l’appel Flash SIOMRI - Solutions Innovantes et Opérationnelles dans la Maîtrise des Risques Industriels en milieu urbain et dense. Les résultats de 13 projets financés seront présentés.
- 25 juillet 2025Pré-annonce : EP PerMed "Test et Démonstration de l’Utilisation de Données Multimodales pour la Médecine Personnalisée" (MultiPMData2026)Le RITC2026 financera des projets de recherche en santé humaine portant sur le développement d’approches innovantes utilisant des données multimodales, afin améliorer et personnaliser la prise en charge de patients atteints de maladies chroniques et de leur(s) comorbidité(s). Les projets de recherche devront aborder un ou plusieurs des aspects suivants :
- Détection ou caractérisation de comorbidités chez les patients souffrant de maladies chroniques ;
- Diagnostique, suivi ou surveillance de la progression d’une maladie chronique, incluant les cas de rémission ou récidive ;
- Transition des soins en hospitalisation vers les soins ambulatoires grâce à la surveillance à distance via des dispositifs portables connectés ou d'autres solutions technologiques ;
- Supports décisionnels à des fins d’interventions médicales stratégiques (ex : type et dosage de la médication)
- Suivi et gestion des traitements multiples (incluant les combinaisons de médications) pour améliorer l’efficacité de la médication ou réduire les effets indésirables ou effets néfastes d’interactions médicamenteuses.
- Adhérence à long-terme des traitements
- 25 juillet 2025PEPR Cell-ID : "Identités et destins cellulaires" - Appel à projets - 2025Une compréhension approfondie du développement cérébral humain est donc essentielle pour combattre ces maladies qui se manifestent durant cette période sensible. Une telle connaissance permettra d’accélérer le diagnostic, d’améliorer la prise en charge et le conseil aux patients, de réduire la charge de la maladie, et de favoriser l’intégration sociale des personnes concernées et de leurs familles. Il s’agit là non seulement d’un impératif de santé publique, mais aussi d’une stratégie nationale à long terme pour le bien-être futur de notre société. Financé par France 2030 avec un budget de 50 millions d’euros sur sept ans, et piloté par le CNRS et l’INSERM, le PEPR Cell-ID vise à développer et appliquer des approches permettant de suivre des cellules individuelles au cours du développement du cerveau et de comparer ces trajectoires à celles observées en situation pathologique. Le PEPR Cell-ID veillera à maintenir une interaction constante avec les parties prenantes institutionnelles, les patients, leurs familles, ainsi que le grand public pour maximiser la visibilité et l’impact de ses actions. Cette initiative constitue une opportunité unique de structurer la communauté scientifique française et de jouer un rôle moteur dans le domaine en plein développement de l’interception cellulaire. Cet appel à projets vise à soutenir et accélérer la mise en œuvre de l’initiative Cell-ID en mobilisant des équipes de recherche, des plateformes technologiques et des collaborations multidisciplinaires pour relever les défis scientifiques, technologiques et de formation au cœur du programme. L’objectif est d’identifier et de financer des projets ambitieux et à fort impact contribuant à une meilleure compréhension des trajectoires cellulaires lors du neurodéveloppement, avec un focus particulier sur les premières déviations conduisant aux cancers cérébraux pédiatriques. Cette démarche inclut des efforts pour développer et intégrer des technologies innovantes d’analyse sur cellules uniques, construire et appliquer des modèles expérimentaux tels que les organoïdes pour l’étude des décisions de destinée cellulaire, générer et exploiter des données pour la modélisation prédictive de la dynamique cellulaire en santé et en maladie, ainsi qu’identifier des signatures (épi)génétiques précoces du développement des tumeurs cérébrales pédiatriques. L’appel cherche également à promouvoir des approches collaboratives et interdisciplinaires reliant biologie, sciences computationnelles, intelligence artificielle, physique, mathématiques et recherche clinique, renforçant ainsi l’écosystème de recherche national. Les propositions doivent s’aligner avec la mission de Cell-ID visant à progresser vers la détection précoce des maladies, l’intervention et les stratégies de traitement personnalisées. Outre les avancées scientifiques et techniques, cet appel soutiendra également des initiatives contribuant à la science ouverte, et engageant les patients, leurs familles ainsi que le grand public pour accroître la visibilité et la pertinence sociétale du programme. Des détails supplémentaires sur le champ thématique sont fournis en section 2.1. En soutenant des projets ciblés dans ces domaines, cet appel contribuera directement aux priorités stratégiques de Cell-ID et aidera à positionner la France comme un leader dans son domaine. L’appel à projets (AAP) est ouvert aux petits consortiums collaboratifs qui rassemblent les synergies nécessaires à la réalisation des travaux proposés, avec un financement allant de 0,8 à 1 million d’euros maximum pour une durée de 3 à 4 ans. Le budget total disponible pour cet appel est de 5 millions d’euros. Cell-ID promeut la recherche collaborative et interdisciplinaire ; par conséquent, les candidatures axées sur une seule thématique ne seront pas prioritaires. La construction des projets pour cet appel se déroulera en 2 étapes avec une première phase obligatoire de dépôt d’une lettre d’intention présentant les objectifs et grandes lignes du projet ainsi que le consortium. Les responsables des propositions sélectionnées lors de cette 1ère phase seront invités à déposer un document complet qui sera évalué par un comité d’experts internationaux du domaine mis en place par l’ANR. Des projets portés par des chercheurs étrangers s’établissant en France, notamment dans le cadre du programme « Choose Europe », sont encouragés.
- 24 juillet 2025Rendez-vous de l’ANR 2025-2026 : ouverture des inscriptionsDès le 4 septembre 2025, l’Agence nationale de la recherche (ANR) organise les Rendez-vous de l’ANR sous forme de webinaires et de rencontres en région. Ils sont destinés aux chercheurs, chercheuses, gestionnaires et acteurs institutionnels de la recherche, notamment pour leur présenter les spécificités du Plan d’action 2026 et des appels à venir, les nouvelles mesures de simplification et les accompagner dans leurs démarches.
- 23 juillet 2025L’ANR participe au 23e Congrès international de nutrition de l’Union internationale des sciences de la nutrition (IUNS-ICN)Du 24 au 29 août 2025, Paris accueille le 23e Congrès international de Nutrition, un événement scientifique d’envergure réunissant chercheurs, experts et institutions du monde entier autour du thème central de l’alimentation durable pour la santé globale. L’Agence nationale de la recherche (ANR), engagée depuis vingt ans dans le soutien à la recherche sur l’alimentation, la nutrition et le développement durable, y prendra part à travers une session dédiée aux liens entre sécurité alimentaire, nutrition et changement climatique.
- 23 juillet 2025PEPR SAMS - "Systèmes Alimentaires Microbiomes et Santé" - Appel à projets 2025Pour répondre à ces enjeux sociaux et de santé, le programme de recherche du PEPR SAMS s'appuie sur deux piliers : le pilier « Microbiomes et Santé » (MS) et le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » (SA). Le présent appel à projets vise à soutenir des projets de recherche originaux favorisant l’innovation et le transfert à la société sur l’ensemble des axes scientifiques des deux piliers et à leur interface. Sont encouragés les projets adressant les questions et domaines de recherche peu ou pas couverts par les projets lauréats du premier appel à projets du PEPR SAMS, mis en place par l’ANR. Le pilier « Microbiomes et santé » se concentre sur la compréhension des facteurs qui déclenchent la transition d’un microbiote sain vers un état de dysbiose, celle-ci devenant essentielle pour prendre des mesures préventives personnalisées et réduire le fardeau des maladies chroniques liées au microbiome humain. Un changement de paradigme visant à transformer à la fois le diagnostic et le suivi, ainsi que la prévention, les traitements et les interventions thérapeutiques, est devenu crucial. Le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » repose sur la reconnaissance de la nécessité de modifier le comportement des consommateurs pour contribuer à la résolution des problématiques de santé publique et d'environnement associées aux régimes alimentaires. Cependant, de tels changements sont difficiles à réaliser pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui disposent de peu de ressources matérielles et éducatives. Un défi important consiste donc à identifier et à analyser dans quelle mesure les interventions publiques, privées et communautaires peuvent encourager et soutenir ces changements, en jouant sur des déterminants individuels ou structurels. Les neuf projets ciblés du PEPR SAMS (https://pepr-sams.fr/projets) visent à développer des outils et plateformes bénéficiant à la communauté scientifique. Il est recommandé que les projets s’appuient sur ces projets ciblés autant que nécessaire et qu’ils fassent apparaître les projets éventuellement mobilisés comme partenaires ou partenaires associés. Un premier appel à projets mis en place par l’ANR pour le PEPR SAMS a conduit au financement de dix projets de recherche pour un montant total de 19,4 Millions d’euros (https://pepr-sams.fr/projets/). Cet appel à projets vise à soutenir des projets d’envergure, d’une durée maximale de 4 ans, avec des financements allant de 1,5 à 1,75 M€ pour le pilier « Microbiomes et Santé », de 0,8 à 1 M€ pour le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » et de 1 à 1,5 M€ pour des projets à l’interface entre les deux piliers. Les responsables de projet lauréats du 1er appel à projets du PEPR SAMS mis en place par l’ANR, ou d’un projet de chaire junior, ne pourront pas être responsable de projet dans le cadre de ce second appel. Il ne sera possible d’être responsable que d’un seul projet dans le cadre de cet appel. L’établissement coordinateur doit être un établissement français d’enseignement supérieur et de recherche. Le consortium devra être composé a minima de 3 structures de recherche différentes dont au moins deux de localisations différentes.
- 23 juillet 2025L’Agence nationale de la recherche publie son rapport d’activité 2024Dans son dernier rapport d’activité, l’Agence nationale de la recherche revient sur les actions engagées, les faits marquants et les chiffres clés de l’année 2024. Avec une mise en page repensée, ce rapport met en lumière la diversité des projets soutenus et reflète le dynamisme d’une agence engagée au service de la recherche française. Il comprend également un encart illustré présentant vingt projets scientifiques emblématiques, témoignant de la diversité des recherches financées.
- 21 juillet 2025L’ANR annonce 5 nouvelles mesures de simplificationDans le cadre du Plan d’action et de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026 publiés aujourd’hui, l’Agence nationale de la recherche (ANR) annonce de nouvelles mesures pour simplifier et optimiser chaque étape de la vie des projets, de l’identification des opportunités de financement à la clôture en passant par le dépôt, la contractualisation et le suivi.
- 21 juillet 2025AAPG 2026 : l’ANR recrute 3 présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un nouvel appel à candidatures pour renouveler les présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifique de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’AAPG 2026, 3 nouveaux postes sont ouverts jusqu’au 04 septembre 2025.
- 21 juillet 2025AAPG - Appel à projets générique 2026Calendrier Prévisionnel de l'AAPG 2026 Etape I
- Juillet 2025 : publication du Plan d’action 2026 et de l’AAPG 2026
- 9 septembre 2025 : publication du Guide de l’AAPG 2026, de la trame de rédaction et du modèle d’attestation PRME ; publication des annexes PRCI ; ouverture d’IRIS pour le dépôt des projets JCJC, PRME, PRC et l’enregistrement des projets PRCE et PRCI (modalité « ANR lead Agency » et « Hors modalité Lead Agency »)
- 14 octobre 2025, 17h (heure de Paris) : clôture du dépôt et enregistrement Etape I
- Février 2026 : notification des résultats Etape 1 aux coordinateurs et coordinatrices d’un projet éligible
- Février 2026 : publication de la trame de rédaction ; ouverture d’IRIS pour le dépôt des projets JCJC, PRME, PRC, PRCE et PRCI (modalité « ANR lead Agency » et « Hors modalité Lead Agency »)
- Fin mars 2026 : clôture du dépôt Etape 2
- Dernière semaine de mai 2026 : ouverture du droit de réponse aux expertises sur IRIS
- Juin 2026 : notification des premiers résultats des projets JCJC, PRME, PRC et PRCE
- A partir de juillet 2026 : contractualisation des projets sélectionnés
- A partir de septembre 2026 jusqu’à décembre 2026 : publication des résultats PRCI selon le calendrier des négociations avec les différentes agences étrangères
- 38 axes de recherche présentés au sein de 7 domaines disciplinaires ;
- 19 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux (trans- ou interdisciplinaires) situés à la croisée de plusieurs secteurs scientifiques.
- Modalité « ANR Lead Agency » : l’ANR prend en charge le dépôt principal et l’évaluation des projets, selon les modalités d’évaluation et le calendrier de l’AAPG. Les collaborations concernées requièrent obligatoirement l’enregistrement du projet auprès de l’ANR en étape 1 de l’AAPG, puis le dépôt d’une proposition détaillée auprès de l’ANR en étape 2. Le partenaire étranger peut avoir à déposer une copie du projet auprès de l’agence de financement étrangère.
- Modalité « Agence Etr Lead Agency » : l’agence de financement collaboratrice prend en charge le dépôt principal et l’évaluation des projets, selon ses propres modalités d’évaluation et son propre calendrier. Les collaborations concernées ne requièrent pas l’enregistrement du projet en étape 1 de l’AAPG. Cependant, une copie du projet tel que déposé auprès de l’agence étrangère est requis, dans un calendrier spécifique.
- « Hors modalité Lead Agency » : les projets sont déposés auprès des deux agences de financement, selon le calendrier et les modalités propres à chaque agence. L’évaluation est menée par chaque agence de financement selon son propre processus d’évaluation et son propre calendrier. Les collaborations concernées requièrent l’enregistrement du projet auprès de l’ANR en étape 1 de l’AAPG, puis le dépôt d’une proposition détaillée auprès de l’ANR en étape 2.
Attention : les résultats des projets PRCI déposés à l’AAPG 2025 seront connus à partir de septembre 2025 jusqu’à décembre 2025, selon le calendrier des négociations avec les agences de financement étrangères. Dans l’attente de ces résultats, nous invitons les coordinateurs et coordinatrices d’un projet PRCI en attente de résultat à procéder à l’enregistrement de leur projet à l’édition 2026 de l’appel (dans le cadre d’une collaboration en modalité « ANR lead agency » ou « hors modalité lead agency » pour l’édition 2026) (ou bien à entamer le dépôt d’un nouveau projet PRC, PRME, JCJC ou l’enregistrement d’un projet PRCE). En cas de sélection pour financement au titre de l’édition 2025, les lauréates et lauréats annuleront leur enregistrement PRCI (ou dépôt de projet PRC, PRME, JCJC ou enregistrement d’un projet PRCE) au titre de l’édition 2026, par courriel à l’adresse aapg.science@agencerecherche.fr.
Reconduction de l’invitation en étape 2 des projets en liste complémentaire S’ils sont redéposés en étape 1 de l’AAPG 2026, les projets classés en liste complémentaire à l’AAPG 2025 mais non sélectionnés pour financement à l’issue du processus sont invités automatiquement en étape 2 de l’AAPG2026, sans évaluation par les comités d’évaluation scientifique, sous réserve d’éligibilité. Les projets concernés doivent avoir le même coordinateur ou la même coordinatrice, le même instrument de financement, le même titre et un consortium comparable, et être complet sur le site de dépôt à date et heure de clôture de l’étape 1 de l’appel. A noter que pour l’édition 2026, les projets PRCE classés en liste complémentaire à l’AAPG 2025 bénéficient du nouveau dispositif de l’AAPG 2026 de simple enregistrement en étape 1 de l’appel. - 21 juillet 2025Publication du Plan d’action et de l’Appel à projets générique 2026 de l’ANR : continuité et nouveaux dispositifsFeuille de route des actions et appels à venir, en particulier de l’Appel à projets générique (AAPG), le Plan d’action 2026 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) est mis en ligne aujourd’hui. Ce plan d’action et l’AAPG 2026 restent très largement positionnés sur la recherche fondamentale, et la recherche « guidée par la curiosité des laboratoires ». Tous les domaines scientifiques pourront être financés, sous réserve de leur excellence scientifique. De nouvelles actions sont également envisagées, notamment pour permettre de renforcer l’implication des équipes de recherche françaises dans les projets européens ainsi que l’efficacité des instruments de financement en faveur de la recherche partenariale public-privé. Enfin, l’ANR présente dans ce document une accélération de la simplification de ses processus. Le Plan d’action 2026 sera présenté aux communautés scientifiques et aux acteurs de l’ESRI lors des Rendez-vous de l’ANR, à partir du mois de septembre, à l’occasion de rencontres de terrain et de webinaires.
- 17 juillet 2025France 2030 - PEPR ATLASea : "Un atlas des génomes marins" - appel à projets 2025
- DIVE-Sea : Sous la coordination du MNHN, 6 expéditions menées en Méditerranée, Bretagne, Manche, Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie ont déjà collecté plus de 2000 spécimens couvrant tous les grands groupes d’eucaryotes marins. La grande majorité sont identifiés à l’espèce par des taxonomistes, et entrés dans les collections du MNHN. De nombreuses autres expéditions sont prévues dans les années à venir.
- SEQ-Sea : Mis en œuvre par le Genoscope (CEA), le séquençage de milliers de génomes marins est un challenge technologique et logistique. Avec déjà plus de 75 génomes séquencés, une phase de montée en puissance est en cours, en parallèle de l’élaboration de protocoles d’extraction d’ADN et de séquençage concernant les taxons les plus difficiles.
- BYTE-Sea : Coordonné par le CNRS et l’Institut Français de Bioinformatique, l’infrastructure informatique nécessaire au programme ATLASea recueille, trace et analyse l’ensemble des données et métadonnées produites, et les présente dans des portails dédiés pour servir la communauté.
- 17 juillet 2025Pré-annonce : Troisième appel à projets transnationaux co-financé du partenariat européen Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)Vision du partenariat SBEP :
- Concevoir, piloter et soutenir une transition équitable et globale vers une économie bleue solide, résiliente et durable.
- Accélérer la transformation pour atteindre en 2030 une économie bleue qui soit neutre pour le climat, durable, productive et compétitive
- Créer, améliorer et maintenir la santé des océans ainsi que le bien-être social, environnemental et économique des populations d'ici 2050.
- Jumeaux numériques de l’Océan à l’échelle des sous-bassins maritimes
- Transition des secteurs de l'économie bleue et le développement de la coexistence et des infrastructures marines multi-usages
- Planification intelligente face au climat et gestion des usages maritimes au niveau régional
- Bioressources bleues : pêcheries et aquaculture durables et nouveaux produits biosourcés
- Communautés et entreprises côtières résilientes
- 11 juillet 2025Une nouvelle Chaire industrielle pour renforcer la souveraineté technologique navale françaiseNantes, le 10 juillet 2025 - Centrale Nantes, Naval Group, le Cetim et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent le lancement de la Chaire industrielle SEALENCE – Solution Élastomère pour l’Acoustique Navale et la Conception Étanche dédiée aux matériaux élastomères en conditions mécaniques extrêmes. Cette Chaire industrielle s’inscrit dans une dynamique d’innovation scientifique et technologique au service de la souveraineté industrielle française.
- 9 juillet 2025Pré-annonce : 4ème édition de l’appel à projet transnational dans le cadre du Partenariat européen Driving Urban Transitions – 2025Contexte et enjeux Notre avenir dépend de la capacité à relever dès maintenant de grands défis complexes, dont beaucoup doivent être abordés dans les villes et par les communautés urbaines. Les villes et les zones urbaines sont au cœur des transformations nécessaires pour que l'Union européenne (UE) atteigne les objectifs de l'accord vert européen (Green Deal) et respecte les engagements liés aux objectifs de développement durable (SDG) de l'Agenda 2030 des Nations unies (ONU), au nouvel agenda urbain d'ONU-Habitat, à l'agenda urbain de l'Union européenne, à l'accord de Paris sur le climat. Objectifs Le partenariat Driving Urban Transitions (DUT) vise à aider à relever ces défis par des approches intégrées afin d'offrir aux décideurs des autorités publiques, y compris les municipalités, des entreprises et, plus généralement, de la société, les moyens de mettre en œuvre et permettre les transformations urbaines nécessaires. Ce partenariat vise à développer, par le biais de projets de recherche et d'innovation, les compétences et les outils (y compris technologiques) permettant de concrétiser et de stimuler les transformations urbaines nécessaires et urgentes, et à mettre en pratique les connaissances et les données existantes et nouvelles. L’objectif principal du premier appel du Partenariat Driving Urban Transitions est de soutenir des projets de recherche et/ou d'innovation transnationaux portant sur les défis urbains afin d'aider les villes dans leur transition vers une économie et un fonctionnement plus durable. Thématiques Les thématiques identifiés pour cet appel sont regroupées selon des "Transition Pathways" :
- La thématique sur les quartiers à énergie positive (PED) vise à développer des solutions innovantes pour la planification, la mise en œuvre à grande échelle et la reproduction des quartiers à énergie positive (PED) dans les zones urbaines et périurbaines en Europe.
- La thématique sur la ville du quart d’heure (15-minute City) vise à encourager les choix de mobilité durable, à redistribuer l’espace urbain et à réorganiser les activités pour rendre les villes plus neutres pour le climat et résilientes, accessibles à tous.
- La thématique sur les économies urbaines circulaires (CUE) vise à favoriser les lieux urbains, les communautés et les quartiers soutenus par des flux de ressources circulaires, tout en améliorant le bien-être de leurs habitants et de leurs écosystèmes. Elle encourage une planification et une conception urbaine fondées sur l’urbanisme régénératif, combinant les principes de l’économie circulaire, la végétalisation urbaine, et un accès équitable aux espaces et ressources urbains.
- 9 juillet 2025Pré-annonce : Appel à projets Transnational Conjoint Water4All 2025 « Eau et santé »Les agences de financement européennes et internationales de 31 pays lancent un appel à projets transnational pour financer des projets de recherche et d'innovation sur « Eau et santé ». Cet appel à projets transnational est lancé dans le cadre du partenariat européen Water4All et soutient des projets de recherche et d'innovation qui portent sur l’eau et la santé visant à relever des défis clés liés au lien entre l'eau et la santé humaine, y compris la qualité de l'eau, les contaminants et les technologies de traitement de l'eau. L'appel prend également en compte l'approche « One Health », reconnaissant les interconnexions entre la santé humaine, environnementale et animale. Conformément aux objectifs stratégiques de Water4All, les résultats des projets doivent contribuer à la mise en œuvre de politiques et stratégies de gestion de l'eau mondiales, européennes et nationales, dans le cadre du Green Deal, de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), de la Transition Juste, des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et de la Stratégie pour la résilience dans le domaine de l’eau. Les propositions devront tenir compte des cadres législatifs et stratégiques appropriés aux niveaux national et international Thématiques de recherche : Le contexte des sujets généraux de l'appel est décrit dans le thème IV (IV.I; IV.III) de l’Agenda stratégique de recherche et d'innovation (SRIA) de Water4All. Les propositions de recherche et d’innovation soumises dans le cadre de cet appel doivent aborder au moins l’un des sujets suivants :
- Thématique 1 : Contaminants transportés par l’eau et risques pour la santé : occurrence, comportement, interactions et vulnérabilité
- Thématique 2 : Outils et technologies innovants pour la surveillance de la qualité de l'eau et de l'exposition aux contaminants via l’eau
- Thématique 3 : Traitement de l'eau et atténuation de l'exposition aux contaminants via l’eau
- Thématique 4 : Gouvernance, innovation socio-économique et intégration des politiques pour l'eau et la santé
- 9 juillet 2025Lancement du LabCom AMIE : une alliance scientifique et industrielle pour des batteries tout-solide ITEN toujours plus performantes et éco-responsablesLyon, le 8 juillet 2025 – L'École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon), le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1, la société ITEN et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent le lancement du LabCom AMIE (Analyse des matériaux et interfaces pour l’énergie). Ce partenariat stratégique, soutenu par l’ANR à hauteur de 363 k€, et réunissant recherche académique et innovation industrielle, vise à repousser les limites en matière de performances techniques, écologiques et durabilité des batteries tout-solide ITEN.
- 8 juillet 2025France 2030 – Attractivité de la recherche française : 15 nouveaux chercheurs et chercheuses distingués dans le cadre des « Chaires d’excellence en Biologie / Santé »Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’accès aux soins, Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, et Charles-Edouard Escurat, directeur général de l’Agence de l’innovation en santé, annoncent le nom des 15 chercheurs et chercheuses distingués par une « Chaires d’excellence en Biologie/Santé » de France 2030. Leurs projets de recherche seront ainsi financés pour une durée de cinq ans. Ce dispositif, qui vise à renforcer l’attractivité de la recherche biomédicale française, soutient des scientifiques d’exception.
- 30 juin 2025Réalités virtuelles et augmentées : un laboratoire d’innovation technologique pour l’immersion multisensorielleLe laboratoire Perception, Représentations, Image Son Musique - PRISM (AMU/CNRS), la société Immersion et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent la création du LabCom LITIMS (Laboratoire d’Innovation Technologique pour l’Immersion Multi-Sensorielle), visant à l’implémentation d'une plateforme technologique pour le prototypage d'applications multisensorielles. Bénéficiant d’un financement de l’ANR de 363 k€ sur 54 mois, et d’un complément apporté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce partenariat ambitionne de se pérenniser grâce à la valorisation des avancées scientifiques et technologiques acquises sur la durée du projet.
- 27 juin 2025Appel à projets générique 2025 : l’ANR publie les premières listes de projets sélectionnésL’Agence nationale de la recherche (ANR) publie, au fil de la tenue des comités d’évaluation scientifique en juin et juillet 2025, les listes des projets de recherche sélectionnés à l’Appel à projets générique (AAPG) 2025, afin de les contractualiser au plus tôt.
- 27 juin 2025Le Hcéres publie le rapport d’évaluation de l’ANRLe Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) a rendu public le 27 juin le rapport d’évaluation concernant l’Agence nationale de la recherche (ANR). Cette évaluation a été conduite par un comité de 9 experts de 4 nationalités différentes présidé par Véronique Halloin, Secrétaire générale du Fonds de la recherche scientifique (Belgique).
- 27 juin 2025A Nice, l’ANR dresse son bilan de vingt ans de recherche pour l’océanDébut juin, Nice a accueilli deux grands rendez-vous internationaux autour de la préservation de l’océan : le One Ocean Science Congress (OOSC), réunissant plus de 2 000 scientifiques, et la 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3). Enjeux de gouvernance, de protection de la biodiversité marine, de lutte contre la pollution plastique ou encore de financement de la recherche : Anne-Hélène Prieur-Richard, responsable du département EERB (Environnements, Écosystèmes et Ressources Biologiques) de l’ANR, revient sur les temps forts de ces événements et sur le bilan de 20 ans de soutien à la recherche océanique à l’ANR.
- 27 juin 2025« Pêche et biodiversité dans l’Océan indien » (Bridges) : un programme de recherche pour penser et coconstruire des usages durables et équitables des ressources marinesLe programme de recherche exploratoire (PEPR) « Pêche et biodiversité dans l’océan Indien » (BRIDGES) concentre ses travaux sur les terrains du sud-ouest de l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, les Comores, le Mozambique et l’espace hauturier Canal du Mozambique et sud-ouest de l’océan Indien), des régions particulièrement concernées par les manifestations du changement climatique et les conflits d’usages liés à la pêche qui en découlent. A la croisée des sciences environnementales, des sciences humaines et sociales, de la diplomatie scientifique, BRIDGES vise à identifier et coconstruire des solutions garantissant la conservation de la biodiversité et une pêche juste et durable face au changement climatique et à une exploitation croissante des ressources marines. Des défis de taille pour ce programme, piloté par le CNRS, l’IFREMER et l’IRD, qui se déploiera sur dix ans grâce à un financement de 28 M€ de France 2030. Rencontre avec Emmanuelle Roque pour l’Ifremer et Joachim Claudet pour le CNRS, codirecteurs du programme, au côté de Frédéric Ménard pour l’IRD.
- 26 juin 20252e participation de l’ANR au festival TURFUDu 1er avril au 5 avril, l’ANR a participé pour la seconde fois au TURFU, festival dédié aux sciences, à l’innovation et aux recherches participatives porté depuis 9 ans par le Dôme, centre de culture scientifique et technique de Caen. 6 équipes lauréates de projets ANR SAPS (« Science avec et pour la société ») ont répondu à l’appel de cette édition qui a réuni 3 400 participants venus « interroger le présent et explorer les futurs possibles ».
- 25 juin 2025Belmont Forum - OCEAN 2 - Vers l'océan que nous voulons : biodiversité et durabilité des écosystèmes pour la nature et le bien-être humainCet appel est une contribution officielle à la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable. Les projets financés par cet appel seront considérés comme officiellement approuvés par les actions de la Décennie, ce qui facilitera l'engagement des équipes de recherche dans le réseau des partenaires et des initiatives de la Décennie de l'océan. Les propositions doivent intégrer des éléments d'au moins un des trois domaines énumérés ci-dessous :
- Conservation de la biodiversité et solutions basées sur la nature.
- Intégration océan-biodiversité-climat.
- Avenirs de la nature, gouvernance des océans et éthique de la durabilité.
- 23 juin 2025BiodivConnect - Restauration de la fonctionnalité, de l’intégrité et de la connectivité des écosystèmes - Biodiversa+ 2026L’appel BiodivConnect est lancé par le partenariat européen pour la biodiversité dans le cadre d’Horizon Europe – Biodiversa+. S’inscrivant dans le programme phare « Soutenir la protection et la restauration de la biodiversité sur terre comme en mer » Il contribuera à atteindre l’un des objectifs stratégiques du partenariat : produire des connaissances appliquées, pratiques et utilisables pour soutenir un changement transformateur visant à arrêter et inverser le déclin de la biodiversité (Agenda stratégique de Recherche et d’Innovation de Biodiversa+). Contexte et priorités de recherche BiodivConnect vise à soutenir une recherche innovante qui contribuera à atteindre et respecter les engagements relatifs à la biodiversité aux niveaux européen et mondial d’ici et au-delà 2030 (exemple : cadre mondial pour la biodiversité de Kumming-Montréal). Les résultats seront destinés à être intégrés aux pratiques de restauration de la nature. L’objectif est de favoriser des écosystèmes et des habitats interconnectés et écologiquement fonctionnels. Une attention particulière est portée à la durabilité et à l’adaptabilité des actions de restauration, ainsi qu’à l’évaluation de leur efficacité dans le temps et à différentes échelles spatiales (locales, régionales, transfrontalières, mondiales, etc.). L’appel couvre tous types d’écosystèmes et d’habitats, dans toutes les régions du monde. Il soutient des projets de recherche et d’innovation de grande qualité adoptant des approches holistiques, systémiques et intégrées. Les projets proposés pourront porter sur divers aspects tels que : différentes catégories d’indicateurs ; études multi-échelles et transposabilité des efforts de restauration ; prises en compte des dimensions écologiques, socio-économiques et socio-culturelles, et/ou des différents niveaux de réglementation et de politiques environnementales, harmonisation, etc. BiodivConnect s’organise autour de trois sujets principaux non mutuellement exclusifs et pouvant se recouper :
- Sujet 1 : Définir des objectifs de restauration (cohérents et opérationnels) et mesurer le succès… … en termes de fonctionnement, d’intégrité et de connectivité des écosystèmes. Les projets sont invités à prendre en compte les évolutions des références de base (shifting baselines) et à intégrer les dimensions écologiques, culturelles et sociales, en s’appuyant sur des approches tournées vers les objectifs.
- Sujet 2 : Transférabilité (significative) et généralisation (efficace) des efforts de restauration de la nature… … pour une meilleure compréhension des méthodes possibles et des opportunités dans des contextes aux enjeux socio-économiques et environnementaux variés.
- Sujet 3 : Résilience et durabilité des efforts de restauration… …à long terme pour les espèces, habitats et écosystèmes restaurés, notamment face au changement climatique et à d’autres perturbations.
- 18 juin 2025Belmont Forum - RESILIENCE : Gestion de la vulnérabilité et de la résilience des systèmes socio-environnementaux dans les territoires exposés - 2025S'inspirant de la récente crise pandémique de la COVID-19, cette nouvelle action de recherche collaborative (CRA), appelée Resilience, s'appuie notamment sur la précédente CRA intitulée Disaster Risk Reduction and Resilience (DR3, 2019) du Belmont Forum et vise à définir et à promouvoir de « nouveaux » concepts de gestion des risques qui tiennent mieux compte du changement global et de l'évolution rapide des relations entre les sociétés et la nature. Parmi les résultats attendus, citons le développement de la science des risques en accord avec la science de la durabilité, la co-production de connaissances, l'accent mis sur les territoires très vulnérables, la gouvernance informée et l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques et de parties prenantes capables de mieux faire face à des risques environnementaux en constante augmentation. Domaines d'intervention L'appel sollicitera des propositions portant sur au moins deux des domaines suivants :
- Domaine 1 : Mieux évaluer les risques dont la complexité augmente avec le changement global
- Domaine 2 : Accorder une attention particulière aux vulnérabilités exacerbées dans les territoires fortement exposés
- Domaine 3 : Développer des solutions innovantes pour la réduction des risques de catastrophes.
- 10 juin 2025Technologies quantiques : 5ème appel à projets QuantERACet appel à projets transnationaux, cofinancé par la commission européenne, est divisé en deux thématiques :
- Quantum Phenomena and Resources (QPR), qui vise à établir les principes fondamentaux des technologies quantiques du futur.
- Applied Quantum Science (AQS), dont l'objectif est d'utiliser les effets quantiques connus et les concepts établis des sciences quantiques, de les transposer en applications technologiques et de développer de nouveaux produits.
- 3 juin 2025Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense : appel thématique Résistance 2025L’actualité récente a permis au grand public de prendre connaissance de faits avérés de désinformation à grande échelle opérés par des puissances hostiles à la France. Ceci illustre concrètement les opérations d’influences étrangères malveillantes. Elles sont au cœur de menaces hybrides impactant, entre autres, le processus démocratique et l’économie dans un monde de moins en moins polarisé et de plus en plus en plus fracturé. C’est pourquoi, L’Agence nationale de la recherche et l’Agence de l’innovation de défense (AID) lancent un appel à projets ASTRID thématique sur le développement de solutions concourantes à la résistance des concitoyens à la désinformation. Par cet appel à projet, les Agences appellent la communauté académique à proposer des projets de recherche d’intérêt civil et défense qui permettront d’une part d’identifier des leviers dans la sphère privée ou publique concourants à l’augmentation de la résistance à la désinformation, d’autre part de définir les outils et méthodes nécessaires à l’activation de ces leviers, et enfin de construire les indicateurs permettant d’en mesurer les effets.
- 24 avril 20254ème appel à projets transnational 2025 du Partenariat européen Clean Energy Transition (CETP)Clean Energy Transition Partnership (CETP) est une initiative transnationale de programmation conjointe de la recherche, du développement technologique et de l'innovation qui vise à stimuler et accélérer la transition énergétique, en s'appuyant sur les acteurs régionaux et nationaux de financement de la recherche et de l'innovation (agences nationales, régions...). L’appel CETP 2025 s’articule autour de 10 modules thématiques d’appel (Call Modules, CM), chacun traitant d’un aspect clé de la transition énergétique. Ces modules sont eux-mêmes issus de 7 initiatives de transition (les Transition Initiatives – TRI), qui identifient les principaux défis à relever pour réussir à la transition vers une énergie propre. Pour l’appel CETP 2025, l’ANR participera à 7 modules thématiques, dont les suivants :
- CM2025-01 (TRI 1 & TRI 6) : Multi-vector interactions between the integrated energy system and industrial frameworks
- CM2025-02 (TRI 1 & TRI 2) : Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration
- CM2025-03A (TRI 2) : Advanced renewable energy (RE) technologies for power production (ROA)
- CM2025-04 (TRI 3) : Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)
- CM2025-05 (TRI 3) : Hydrogen & renewable fuels. Concernant la production d'hydrogène, seule la production d'hydrogène vert sera éligible à l'ANR.
- CM2025-06 (TRI 4) : Heating and cooling technologies. Seuls les projets de recherche appliquée et de développement (« Applied research and development projects ») - atteignant un niveau TRL 4, 5 ou 6 après l'achèvement du projet - seront éligibles à l'ANR.
- CM2025-09 (TRI 7) : Clean energy integration in the built environment
- 17 avril 2025Appel à projets de recherche Maladie de Charcot - SLA Cet appel à projet vise à réunir des scientifiques pour établir et développer une collaboration autour d’un projet de recherche interdisciplinaire commun, centré sur les besoins des patients atteints de la maladie de Charcot, en s’appuyant sur des expertises complémentaires. En vue d’une meilleure approche thérapeutique, le projet de recherche pourra couvrir un des champs de recherche suivants :
- Identification des éventuels signes précurseurs visibles avant l’apparition des troubles moteurs et/ou facteurs environnementaux, sociaux et comportementaux favorisant l’apparition de la maladie ;
- Recherche des causes de la maladie et compréhension des mécanismes physiopathologiques. Identification des déterminants moléculaires et cellulaires impliqués. Identification de nouveaux gènes et de leurs mutations ;
- Identification et caractérisation de biomarqueurs pour le diagnostic et le pronostic, qui pourront permettre de diagnostiquer plus tôt la maladie et découvrir des pistes pour ralentir sa progression ;
- Stratification des patients par la mise en place de mesures et de technologies pour caractériser les différents sous-groupes cliniques ;
- Développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.
- L’amélioration de la prise en charge médico-sociale et multidisciplinaire des patients avec la recherche/utilisation de dispositifs d’assistance pertinents pour maintenir leur qualité de vie ;
- L’association d’investigations sur les aspects éthiques et/ou médico-économiques des points d’étude cités ci-dessus ;
- L’identification de nouveaux critères d’évaluation cliniques afin d’améliorer les résultats de futurs essais cliniques.
- au minimum deux partenaires
- au moins un partenaire de type « organisme de recherche ou assimilés »
- 14 avril 2025France 2030 - PEPR "SVA : Sélection Végétale Avancée" - Appel à projets 2025Le programme SVA est structuré autour de quatre axes complémentaires. Il vise à maîtriser les techniques de l’édition des génomes sur un large panel d’espèces (Axe 1) tout en explorant son intégration dans les schémas de sélection, en complément d’autres outils d’aide à la sélection tel que la sélection génomique (Axe 3). Il entend évaluer, à travers des preuves de concept, le potentiel de l’édition des génomes pour contribuer aux objectifs de sélection adaptés aux systèmes agroécologiques dans un contexte de dérèglement climatique (Axe 2). Par ailleurs, le programme prévoit d’analyser et d’accompagner les processus d’innovation autour de l’édition des génomes en sélection végétale, en explorant les tensions et complémentarités avec les enjeux des transitions agroécologiques (Axe 4). Le programme SVA soutient financièrement des projets de recherche qui s’inscrivent dans ces objectifs scientifiques. Il finance quatre projets ciblés, ainsi que les projets de recherche qui seront sélectionnés via cet appel à projets. Les projets proposés doivent s’inscrire dans un ou plusieurs des quatre axes mentionnés ci-dessus et peuvent être complémentaires aux projets ciblés. Doté d’un montant de 7 M€, cet appel à projets financera des projets de recherche d’une durée maximale de 4 ans pour un montant d’aide minimal de 400k€ et maximal de 500 k€ par projet. Il est recommandé que la moitié de l’aide demandée soit dédiée au recrutement de post doctorants et doctorants. Les bénéficiaires des aides sont des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche, ou des groupements de ces établissements. Les entreprises et les établissements étrangers pourront avoir le statut d'Établissement partenaire dans les projets, mais ne bénéficieront pas de financement au titre de cette participation. L'appel à projets se déroulera en 2 phases. Dans une première phase, obligatoire et sélective, le porteur de projet déposera une lettre d’intention de 5 pages maximum, qui sera évaluée par un comité de pilotage, en association avec la présidence du comité international qui évaluera les propositions en phase 2. En effet, dans une seconde phase, les porteurs des lettres d’intention retenues en phase 1 seront appelés à déposer des projets complets, qui seront évalués par un comité international mandaté par l’ANR.
- 11 avril 2025France 2030 NMRC - Evaluation des nouveaux outils, nouveaux usages et nouvelles approches méthodologiques de recherche clinique – Appel à manifestation d’intérêtLe présent appel à manifestation vise à sélectionner des cas pilotes à même de répondre à l’objectif de démonstration de la valeur des nouveaux outils et nouvelles méthodologies de recherche clinique, en remplacement ou en complément des plans de développement classiques dans un but de diffusion de ces pratiques afin de contribuer à l’accélération des développements des technologies de santé innovantes. Les cas pilotes sélectionnés bénéficieront d’un suivi du GT Méthodologie co-piloté par l’AIS et F-CRIN. Ce suivi pourra se traduire, au cas par cas, par un suivi simple opérationnel, des recommandations d’experts sur le design, un appui règlementaire, un appui du Health Data Hub. Si une étude ancillaire s’avère nécessaire pour démontrer et mesurer la valeur du recours à ces approches, le cas pilote pourra bénéficier d’un financement au titre de France 2030 pour une durée de 18 à 24 mois et un montant de l’ordre de 250 k€. L’établissement coordinateur doit être une personne morale enregistrée en France et peut être un établissement de santé, un organisme de recherche ou un industriel promoteur d’étude (sauf en cas d’étude ancillaire financée au titre de France 2030). Les partenariats réunis sous forme de consortium et présentant une diversité de profils (promoteur, fournisseur de données, fournisseur de méthodologie, et/ou solution innovante, association de patients, professionnels de santé) sont fortement encouragés. La sélection en tant que « cas pilote » apportera, sans présager des résultats intrinsèques du projet, une reconnaissance de l’intérêt de sa démarche et de la capacité du promoteur et de ses partenaires à porter le projet et à contribuer à démontrer l’apport de nouvelles méthodologies. La sélection des cas pilotes dans le cadre de cet appel se déroulera en 2 étapes :
- 1ère phase : dépôt d’une lettre d’intention de 5 pages maximum présentant les objectifs et grandes lignes du projet ainsi que le consortium pressenti
- 2ème phase : les responsables des projets pré-sélectionnés lors de la 1ère phase seront invités à déposer un document complet (maximum 15 pages).
- 3 avril 2025Appel Afrique-Europe – "Services climatiques pour la réduction des risques en Afrique de l’Ouest" (CS4RRA) – 2026Les pays de l’Afrique de l’Ouest font face à l’urgence des enjeux climatiques, incluant la dégradation de l’environnement, la désertification, la variabilité des précipitations, les vagues de chaleurs, les inondations et la réduction de la productivité agricole. L’accélération des impacts du changement climatique, en plus de facteurs socio-économiques tels la croissance démographique et l’urbanisation, accentuent les défis climatiques. L’initiative “Services Climatiques pour la Réduction des Risques en Afrique de l’Ouest” (CS4RRA) lancée en 2023, est une action lancée conjointement par des pays européens en collaboration avec des institutions de l’Afrique de l’Ouest, dont ACMAD, AGRHYMET/ CILSS, WASCAL, les Centres africains d’Excellence et les agences de financement africaines. Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience climatique par les Savoirs, l’Innovation et le Renforcement des Capacités (SIRC), mobilisant les résultats des précédents programmes de l’Union Européenne (UE) et l’Union Africaine (UA) tels que (Horizon2020, Joint Programme Initiative Climate/SINCERE, Copernicus CCS). Thèmes Les propositions de recherche et d’innovation déposées dans le cadre de cet appel doivent porter sur une ou plusieurs des thématiques suivantes :
- Amélioration des Systèmes d’alerte précoce (Early Warning System) ;
- Amélioration de l’évaluation opérationnelle et de la prévention des risques sécuritaires liés au climat ;
- Amélioration des mécanismes de financement et de l’intégration institutionnelle des services climatiques.
- Répondre aux trois piliers de CS4RRA : Savoirs, Renforcement des Capacités et l'Innovation (SIRC) ;
- Suivre des approches inter- et transdisciplinaires encourageant la co-création d'activités entre les partenaires académiques et non-académiques (décideurs politiques, société et économie) ;
- Répondre aux besoins spécifiques liés au changement climatique exprimés par les parties prenantes d'Afrique de l'Ouest ;
- Associer la recherche et l'innovation (dont l’innovation sociale), faisant le lien entre l'excellence scientifique et l'impact social
- 27 mars 2025Soutien aux Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux - SRSEI 2025Le programme SRSEI a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant dans des laboratoires français ayant déposé en tant que coordinatrice/coordinateur un projet de recherche à des appels collaboratifs européens (Horizon Europe) ou internationaux de renforcer la qualité de leur candidature (proposition complète ou audition) pour la seconde étape de l’appel visé. Dans le cadre de cet appel, seules sont attendues des propositions ayant pour objet de renforcer un réseau scientifique européen ou international, coordonné par une équipe française ayant été invité à poursuivre sa candidature à la seconde étape d’un appel Européen ou international en plusieurs étapes. NB : Pour toute information ou orientation concernant les appels « Horizon Europe », veuillez contacter les PCN (Points de Contact Nationaux). Les propositions sélectionnées recevront une aide maximale de 17 k€ pour une durée de 12 mois. L’aide reçue financera exclusivement des actions permettant au réseau scientifique de se retrouver pour préparer la seconde étape de la candidature Européenne ou internationale (frais de mission, de réunion, de réception, etc…) et/ ou de la prestation de service pour aider la coordinatrice/ le coordinateur à finaliser le projet européen ou international. L'ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de décision et la mise en place des financements :
- un dossier de soumission simplifié ;
- un bénéficiaire unique de l'aide pour le compte du consortium complet : la tutelle gestionnaire de l’entité publique ou équivalente française ;
- une sélection simplifiée basée sur l’évaluation déjà réalisée par l’organisme de financement Européen/ international ;
- une procédure de décision de financement unilatérale
Fil info de l'ANR
- 12 septembre 2025MRSEI 2026 : l’ANR recrute une présidente ou un président de comité d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un appel à candidatures pour renouveler la présidence du comité d’évaluation scientifique du programme Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’appel MRSEI 2026, un poste est ouvert jusqu’au 05 octobre 2025.
- 12 septembre 2025AAPG 2026 : l’ANR recrute 1 président ou présidente de comité d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un nouvel appel à candidatures pour renouveler les présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifique de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’AAPG 2026, 1 nouveau poste est ouvert jusqu’au 30 septembre 2025.
- 8 septembre 2025Choose France for Science - Appel à manifestation d’intérêt - 2025Ce programme de chaires d’excellence à destination des chercheuses et chercheurs et ingénieurs de très haut niveau exerçant leurs activités à l’étranger a ainsi pour objectif d’offrir à des chercheuses et chercheurs de premier plan des financements pour mener en France de nouveaux projets d’envergure sur une durée de 3 ans. Ces chaires seront ouvertes uniquement à des chercheurs exerçant à l’étranger désirant venir créer une équipe ou rejoindre une structure en France. Elles permettront le développement de leurs programmes de recherche et seront un levier pour candidater aux appels d’offres européens d’envergure. Dans ce cadre, les universités, les écoles et les organismes de recherche identifient des chercheurs internationaux prêts à venir s’installer en Europe. Les chercheurs identifiés sont invités à construire, avec l’institution d’accueil, un projet de recherche, en particulier en lien avec les thématiques suivantes :
- La recherche en santé
- Le climat, la biodiversité et les sociétés durables
- Le numérique et l’intelligence artificielle
- Les études spatiales
- L’agriculture, l’alimentation durable, les forêts et les ressources naturelles
- Les énergies décarbonées
- Les composants, les systèmes et les infrastructures numériques
- 4 septembre 20254 des 9 lauréats français de l’ERC STG 2025 en SHS ont bénéficié du dispositif « Access ERC » de l’ANRLe 4 septembre 2025, le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié la liste des lauréats de son appel Starting Grants 2025. 4 des 9 lauréats français dans le domaine des Sciences humaines et sociales (SHS) ont été bénéficiaires d’un financement « Access ERC » de l’Agence nationale de la recherche (ANR). L’occasion de mettre en lumière ce programme récent, ouvert spécifiquement aux disciplines des SHS, qui accompagne de jeunes chercheurs et chercheuses dans la préparation d’une candidature à l’ERC.
- 4 septembre 2025L’Agence nationale de la recherche (ANR) réorganise sa Direction générale déléguée à la science et crée une Direction de la recherche partenarialeDirigée par Thibault Cantat, la Direction générale déléguée à la science (DGDS) a pour ambition de renforcer les transversalités et la capacité à porter des visions scientifiques d’avenir.
- 28 août 2025Matinée de tables rondes et d’échanges autour de l’appel Flash SIOMRILe 23 septembre à Rouen, la Région Normandie, la Région Hauts-de-France et l'Agence nationale de la recherche (ANR) organisent une matinée de tables rondes et d’échanges autour de l’appel Flash SIOMRI - Solutions Innovantes et Opérationnelles dans la Maîtrise des Risques Industriels en milieu urbain et dense. Les résultats de 13 projets financés seront présentés.
- 25 juillet 2025Pré-annonce : EP PerMed "Test et Démonstration de l’Utilisation de Données Multimodales pour la Médecine Personnalisée" (MultiPMData2026)Le RITC2026 financera des projets de recherche en santé humaine portant sur le développement d’approches innovantes utilisant des données multimodales, afin améliorer et personnaliser la prise en charge de patients atteints de maladies chroniques et de leur(s) comorbidité(s). Les projets de recherche devront aborder un ou plusieurs des aspects suivants :
- Détection ou caractérisation de comorbidités chez les patients souffrant de maladies chroniques ;
- Diagnostique, suivi ou surveillance de la progression d’une maladie chronique, incluant les cas de rémission ou récidive ;
- Transition des soins en hospitalisation vers les soins ambulatoires grâce à la surveillance à distance via des dispositifs portables connectés ou d'autres solutions technologiques ;
- Supports décisionnels à des fins d’interventions médicales stratégiques (ex : type et dosage de la médication)
- Suivi et gestion des traitements multiples (incluant les combinaisons de médications) pour améliorer l’efficacité de la médication ou réduire les effets indésirables ou effets néfastes d’interactions médicamenteuses.
- Adhérence à long-terme des traitements
- 25 juillet 2025PEPR Cell-ID : "Identités et destins cellulaires" - Appel à projets - 2025Une compréhension approfondie du développement cérébral humain est donc essentielle pour combattre ces maladies qui se manifestent durant cette période sensible. Une telle connaissance permettra d’accélérer le diagnostic, d’améliorer la prise en charge et le conseil aux patients, de réduire la charge de la maladie, et de favoriser l’intégration sociale des personnes concernées et de leurs familles. Il s’agit là non seulement d’un impératif de santé publique, mais aussi d’une stratégie nationale à long terme pour le bien-être futur de notre société. Financé par France 2030 avec un budget de 50 millions d’euros sur sept ans, et piloté par le CNRS et l’INSERM, le PEPR Cell-ID vise à développer et appliquer des approches permettant de suivre des cellules individuelles au cours du développement du cerveau et de comparer ces trajectoires à celles observées en situation pathologique. Le PEPR Cell-ID veillera à maintenir une interaction constante avec les parties prenantes institutionnelles, les patients, leurs familles, ainsi que le grand public pour maximiser la visibilité et l’impact de ses actions. Cette initiative constitue une opportunité unique de structurer la communauté scientifique française et de jouer un rôle moteur dans le domaine en plein développement de l’interception cellulaire. Cet appel à projets vise à soutenir et accélérer la mise en œuvre de l’initiative Cell-ID en mobilisant des équipes de recherche, des plateformes technologiques et des collaborations multidisciplinaires pour relever les défis scientifiques, technologiques et de formation au cœur du programme. L’objectif est d’identifier et de financer des projets ambitieux et à fort impact contribuant à une meilleure compréhension des trajectoires cellulaires lors du neurodéveloppement, avec un focus particulier sur les premières déviations conduisant aux cancers cérébraux pédiatriques. Cette démarche inclut des efforts pour développer et intégrer des technologies innovantes d’analyse sur cellules uniques, construire et appliquer des modèles expérimentaux tels que les organoïdes pour l’étude des décisions de destinée cellulaire, générer et exploiter des données pour la modélisation prédictive de la dynamique cellulaire en santé et en maladie, ainsi qu’identifier des signatures (épi)génétiques précoces du développement des tumeurs cérébrales pédiatriques. L’appel cherche également à promouvoir des approches collaboratives et interdisciplinaires reliant biologie, sciences computationnelles, intelligence artificielle, physique, mathématiques et recherche clinique, renforçant ainsi l’écosystème de recherche national. Les propositions doivent s’aligner avec la mission de Cell-ID visant à progresser vers la détection précoce des maladies, l’intervention et les stratégies de traitement personnalisées. Outre les avancées scientifiques et techniques, cet appel soutiendra également des initiatives contribuant à la science ouverte, et engageant les patients, leurs familles ainsi que le grand public pour accroître la visibilité et la pertinence sociétale du programme. Des détails supplémentaires sur le champ thématique sont fournis en section 2.1. En soutenant des projets ciblés dans ces domaines, cet appel contribuera directement aux priorités stratégiques de Cell-ID et aidera à positionner la France comme un leader dans son domaine. L’appel à projets (AAP) est ouvert aux petits consortiums collaboratifs qui rassemblent les synergies nécessaires à la réalisation des travaux proposés, avec un financement allant de 0,8 à 1 million d’euros maximum pour une durée de 3 à 4 ans. Le budget total disponible pour cet appel est de 5 millions d’euros. Cell-ID promeut la recherche collaborative et interdisciplinaire ; par conséquent, les candidatures axées sur une seule thématique ne seront pas prioritaires. La construction des projets pour cet appel se déroulera en 2 étapes avec une première phase obligatoire de dépôt d’une lettre d’intention présentant les objectifs et grandes lignes du projet ainsi que le consortium. Les responsables des propositions sélectionnées lors de cette 1ère phase seront invités à déposer un document complet qui sera évalué par un comité d’experts internationaux du domaine mis en place par l’ANR. Des projets portés par des chercheurs étrangers s’établissant en France, notamment dans le cadre du programme « Choose Europe », sont encouragés.
- 24 juillet 2025Rendez-vous de l’ANR 2025-2026 : ouverture des inscriptionsDès le 4 septembre 2025, l’Agence nationale de la recherche (ANR) organise les Rendez-vous de l’ANR sous forme de webinaires et de rencontres en région. Ils sont destinés aux chercheurs, chercheuses, gestionnaires et acteurs institutionnels de la recherche, notamment pour leur présenter les spécificités du Plan d’action 2026 et des appels à venir, les nouvelles mesures de simplification et les accompagner dans leurs démarches.
- 23 juillet 2025L’ANR participe au 23e Congrès international de nutrition de l’Union internationale des sciences de la nutrition (IUNS-ICN)Du 24 au 29 août 2025, Paris accueille le 23e Congrès international de Nutrition, un événement scientifique d’envergure réunissant chercheurs, experts et institutions du monde entier autour du thème central de l’alimentation durable pour la santé globale. L’Agence nationale de la recherche (ANR), engagée depuis vingt ans dans le soutien à la recherche sur l’alimentation, la nutrition et le développement durable, y prendra part à travers une session dédiée aux liens entre sécurité alimentaire, nutrition et changement climatique.
- 23 juillet 2025PEPR SAMS - "Systèmes Alimentaires Microbiomes et Santé" - Appel à projets 2025Pour répondre à ces enjeux sociaux et de santé, le programme de recherche du PEPR SAMS s'appuie sur deux piliers : le pilier « Microbiomes et Santé » (MS) et le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » (SA). Le présent appel à projets vise à soutenir des projets de recherche originaux favorisant l’innovation et le transfert à la société sur l’ensemble des axes scientifiques des deux piliers et à leur interface. Sont encouragés les projets adressant les questions et domaines de recherche peu ou pas couverts par les projets lauréats du premier appel à projets du PEPR SAMS, mis en place par l’ANR. Le pilier « Microbiomes et santé » se concentre sur la compréhension des facteurs qui déclenchent la transition d’un microbiote sain vers un état de dysbiose, celle-ci devenant essentielle pour prendre des mesures préventives personnalisées et réduire le fardeau des maladies chroniques liées au microbiome humain. Un changement de paradigme visant à transformer à la fois le diagnostic et le suivi, ainsi que la prévention, les traitements et les interventions thérapeutiques, est devenu crucial. Le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » repose sur la reconnaissance de la nécessité de modifier le comportement des consommateurs pour contribuer à la résolution des problématiques de santé publique et d'environnement associées aux régimes alimentaires. Cependant, de tels changements sont difficiles à réaliser pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui disposent de peu de ressources matérielles et éducatives. Un défi important consiste donc à identifier et à analyser dans quelle mesure les interventions publiques, privées et communautaires peuvent encourager et soutenir ces changements, en jouant sur des déterminants individuels ou structurels. Les neuf projets ciblés du PEPR SAMS (https://pepr-sams.fr/projets) visent à développer des outils et plateformes bénéficiant à la communauté scientifique. Il est recommandé que les projets s’appuient sur ces projets ciblés autant que nécessaire et qu’ils fassent apparaître les projets éventuellement mobilisés comme partenaires ou partenaires associés. Un premier appel à projets mis en place par l’ANR pour le PEPR SAMS a conduit au financement de dix projets de recherche pour un montant total de 19,4 Millions d’euros (https://pepr-sams.fr/projets/). Cet appel à projets vise à soutenir des projets d’envergure, d’une durée maximale de 4 ans, avec des financements allant de 1,5 à 1,75 M€ pour le pilier « Microbiomes et Santé », de 0,8 à 1 M€ pour le pilier « Consommation et Systèmes Alimentaires » et de 1 à 1,5 M€ pour des projets à l’interface entre les deux piliers. Les responsables de projet lauréats du 1er appel à projets du PEPR SAMS mis en place par l’ANR, ou d’un projet de chaire junior, ne pourront pas être responsable de projet dans le cadre de ce second appel. Il ne sera possible d’être responsable que d’un seul projet dans le cadre de cet appel. L’établissement coordinateur doit être un établissement français d’enseignement supérieur et de recherche. Le consortium devra être composé a minima de 3 structures de recherche différentes dont au moins deux de localisations différentes.
- 23 juillet 2025L’Agence nationale de la recherche publie son rapport d’activité 2024Dans son dernier rapport d’activité, l’Agence nationale de la recherche revient sur les actions engagées, les faits marquants et les chiffres clés de l’année 2024. Avec une mise en page repensée, ce rapport met en lumière la diversité des projets soutenus et reflète le dynamisme d’une agence engagée au service de la recherche française. Il comprend également un encart illustré présentant vingt projets scientifiques emblématiques, témoignant de la diversité des recherches financées.
- 21 juillet 2025L’ANR annonce 5 nouvelles mesures de simplificationDans le cadre du Plan d’action et de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026 publiés aujourd’hui, l’Agence nationale de la recherche (ANR) annonce de nouvelles mesures pour simplifier et optimiser chaque étape de la vie des projets, de l’identification des opportunités de financement à la clôture en passant par le dépôt, la contractualisation et le suivi.
- 21 juillet 2025AAPG 2026 : l’ANR recrute 3 présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifiqueL’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un nouvel appel à candidatures pour renouveler les présidentes et présidents de comités d’évaluation scientifique de l’Appel à projets générique (AAPG) 2026. La mise en œuvre de l’évaluation et la sélection des projets déposés aux appels de l’Agence sont réalisées par des comités composés de personnalités scientifiques indépendantes, et s’appuient sur une communauté d’expertes et d’experts scientifiques, la plus large possible. Dans le cadre de l’AAPG 2026, 3 nouveaux postes sont ouverts jusqu’au 04 septembre 2025.
- 21 juillet 2025AAPG - Appel à projets générique 2026Calendrier Prévisionnel de l'AAPG 2026 Etape I
- Juillet 2025 : publication du Plan d’action 2026 et de l’AAPG 2026
- 9 septembre 2025 : publication du Guide de l’AAPG 2026, de la trame de rédaction et du modèle d’attestation PRME ; publication des annexes PRCI ; ouverture d’IRIS pour le dépôt des projets JCJC, PRME, PRC et l’enregistrement des projets PRCE et PRCI (modalité « ANR lead Agency » et « Hors modalité Lead Agency »)
- 14 octobre 2025, 17h (heure de Paris) : clôture du dépôt et enregistrement Etape I
- Février 2026 : notification des résultats Etape 1 aux coordinateurs et coordinatrices d’un projet éligible
- Février 2026 : publication de la trame de rédaction ; ouverture d’IRIS pour le dépôt des projets JCJC, PRME, PRC, PRCE et PRCI (modalité « ANR lead Agency » et « Hors modalité Lead Agency »)
- Fin mars 2026 : clôture du dépôt Etape 2
- Dernière semaine de mai 2026 : ouverture du droit de réponse aux expertises sur IRIS
- Juin 2026 : notification des premiers résultats des projets JCJC, PRME, PRC et PRCE
- A partir de juillet 2026 : contractualisation des projets sélectionnés
- A partir de septembre 2026 jusqu’à décembre 2026 : publication des résultats PRCI selon le calendrier des négociations avec les différentes agences étrangères
- 38 axes de recherche présentés au sein de 7 domaines disciplinaires ;
- 19 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux (trans- ou interdisciplinaires) situés à la croisée de plusieurs secteurs scientifiques.
- Modalité « ANR Lead Agency » : l’ANR prend en charge le dépôt principal et l’évaluation des projets, selon les modalités d’évaluation et le calendrier de l’AAPG. Les collaborations concernées requièrent obligatoirement l’enregistrement du projet auprès de l’ANR en étape 1 de l’AAPG, puis le dépôt d’une proposition détaillée auprès de l’ANR en étape 2. Le partenaire étranger peut avoir à déposer une copie du projet auprès de l’agence de financement étrangère.
- Modalité « Agence Etr Lead Agency » : l’agence de financement collaboratrice prend en charge le dépôt principal et l’évaluation des projets, selon ses propres modalités d’évaluation et son propre calendrier. Les collaborations concernées ne requièrent pas l’enregistrement du projet en étape 1 de l’AAPG. Cependant, une copie du projet tel que déposé auprès de l’agence étrangère est requis, dans un calendrier spécifique.
- « Hors modalité Lead Agency » : les projets sont déposés auprès des deux agences de financement, selon le calendrier et les modalités propres à chaque agence. L’évaluation est menée par chaque agence de financement selon son propre processus d’évaluation et son propre calendrier. Les collaborations concernées requièrent l’enregistrement du projet auprès de l’ANR en étape 1 de l’AAPG, puis le dépôt d’une proposition détaillée auprès de l’ANR en étape 2.
Attention : les résultats des projets PRCI déposés à l’AAPG 2025 seront connus à partir de septembre 2025 jusqu’à décembre 2025, selon le calendrier des négociations avec les agences de financement étrangères. Dans l’attente de ces résultats, nous invitons les coordinateurs et coordinatrices d’un projet PRCI en attente de résultat à procéder à l’enregistrement de leur projet à l’édition 2026 de l’appel (dans le cadre d’une collaboration en modalité « ANR lead agency » ou « hors modalité lead agency » pour l’édition 2026) (ou bien à entamer le dépôt d’un nouveau projet PRC, PRME, JCJC ou l’enregistrement d’un projet PRCE). En cas de sélection pour financement au titre de l’édition 2025, les lauréates et lauréats annuleront leur enregistrement PRCI (ou dépôt de projet PRC, PRME, JCJC ou enregistrement d’un projet PRCE) au titre de l’édition 2026, par courriel à l’adresse aapg.science@agencerecherche.fr.
Reconduction de l’invitation en étape 2 des projets en liste complémentaire S’ils sont redéposés en étape 1 de l’AAPG 2026, les projets classés en liste complémentaire à l’AAPG 2025 mais non sélectionnés pour financement à l’issue du processus sont invités automatiquement en étape 2 de l’AAPG2026, sans évaluation par les comités d’évaluation scientifique, sous réserve d’éligibilité. Les projets concernés doivent avoir le même coordinateur ou la même coordinatrice, le même instrument de financement, le même titre et un consortium comparable, et être complet sur le site de dépôt à date et heure de clôture de l’étape 1 de l’appel. A noter que pour l’édition 2026, les projets PRCE classés en liste complémentaire à l’AAPG 2025 bénéficient du nouveau dispositif de l’AAPG 2026 de simple enregistrement en étape 1 de l’appel. - 21 juillet 2025Publication du Plan d’action et de l’Appel à projets générique 2026 de l’ANR : continuité et nouveaux dispositifsFeuille de route des actions et appels à venir, en particulier de l’Appel à projets générique (AAPG), le Plan d’action 2026 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) est mis en ligne aujourd’hui. Ce plan d’action et l’AAPG 2026 restent très largement positionnés sur la recherche fondamentale, et la recherche « guidée par la curiosité des laboratoires ». Tous les domaines scientifiques pourront être financés, sous réserve de leur excellence scientifique. De nouvelles actions sont également envisagées, notamment pour permettre de renforcer l’implication des équipes de recherche françaises dans les projets européens ainsi que l’efficacité des instruments de financement en faveur de la recherche partenariale public-privé. Enfin, l’ANR présente dans ce document une accélération de la simplification de ses processus. Le Plan d’action 2026 sera présenté aux communautés scientifiques et aux acteurs de l’ESRI lors des Rendez-vous de l’ANR, à partir du mois de septembre, à l’occasion de rencontres de terrain et de webinaires.
- 17 juillet 2025France 2030 - PEPR ATLASea : "Un atlas des génomes marins" - appel à projets 2025
- DIVE-Sea : Sous la coordination du MNHN, 6 expéditions menées en Méditerranée, Bretagne, Manche, Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie ont déjà collecté plus de 2000 spécimens couvrant tous les grands groupes d’eucaryotes marins. La grande majorité sont identifiés à l’espèce par des taxonomistes, et entrés dans les collections du MNHN. De nombreuses autres expéditions sont prévues dans les années à venir.
- SEQ-Sea : Mis en œuvre par le Genoscope (CEA), le séquençage de milliers de génomes marins est un challenge technologique et logistique. Avec déjà plus de 75 génomes séquencés, une phase de montée en puissance est en cours, en parallèle de l’élaboration de protocoles d’extraction d’ADN et de séquençage concernant les taxons les plus difficiles.
- BYTE-Sea : Coordonné par le CNRS et l’Institut Français de Bioinformatique, l’infrastructure informatique nécessaire au programme ATLASea recueille, trace et analyse l’ensemble des données et métadonnées produites, et les présente dans des portails dédiés pour servir la communauté.
- 17 juillet 2025Pré-annonce : Troisième appel à projets transnationaux co-financé du partenariat européen Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)Vision du partenariat SBEP :
- Concevoir, piloter et soutenir une transition équitable et globale vers une économie bleue solide, résiliente et durable.
- Accélérer la transformation pour atteindre en 2030 une économie bleue qui soit neutre pour le climat, durable, productive et compétitive
- Créer, améliorer et maintenir la santé des océans ainsi que le bien-être social, environnemental et économique des populations d'ici 2050.
- Jumeaux numériques de l’Océan à l’échelle des sous-bassins maritimes
- Transition des secteurs de l'économie bleue et le développement de la coexistence et des infrastructures marines multi-usages
- Planification intelligente face au climat et gestion des usages maritimes au niveau régional
- Bioressources bleues : pêcheries et aquaculture durables et nouveaux produits biosourcés
- Communautés et entreprises côtières résilientes
- 11 juillet 2025Une nouvelle Chaire industrielle pour renforcer la souveraineté technologique navale françaiseNantes, le 10 juillet 2025 - Centrale Nantes, Naval Group, le Cetim et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent le lancement de la Chaire industrielle SEALENCE – Solution Élastomère pour l’Acoustique Navale et la Conception Étanche dédiée aux matériaux élastomères en conditions mécaniques extrêmes. Cette Chaire industrielle s’inscrit dans une dynamique d’innovation scientifique et technologique au service de la souveraineté industrielle française.
- 9 juillet 2025Pré-annonce : 4ème édition de l’appel à projet transnational dans le cadre du Partenariat européen Driving Urban Transitions – 2025Contexte et enjeux Notre avenir dépend de la capacité à relever dès maintenant de grands défis complexes, dont beaucoup doivent être abordés dans les villes et par les communautés urbaines. Les villes et les zones urbaines sont au cœur des transformations nécessaires pour que l'Union européenne (UE) atteigne les objectifs de l'accord vert européen (Green Deal) et respecte les engagements liés aux objectifs de développement durable (SDG) de l'Agenda 2030 des Nations unies (ONU), au nouvel agenda urbain d'ONU-Habitat, à l'agenda urbain de l'Union européenne, à l'accord de Paris sur le climat. Objectifs Le partenariat Driving Urban Transitions (DUT) vise à aider à relever ces défis par des approches intégrées afin d'offrir aux décideurs des autorités publiques, y compris les municipalités, des entreprises et, plus généralement, de la société, les moyens de mettre en œuvre et permettre les transformations urbaines nécessaires. Ce partenariat vise à développer, par le biais de projets de recherche et d'innovation, les compétences et les outils (y compris technologiques) permettant de concrétiser et de stimuler les transformations urbaines nécessaires et urgentes, et à mettre en pratique les connaissances et les données existantes et nouvelles. L’objectif principal du premier appel du Partenariat Driving Urban Transitions est de soutenir des projets de recherche et/ou d'innovation transnationaux portant sur les défis urbains afin d'aider les villes dans leur transition vers une économie et un fonctionnement plus durable. Thématiques Les thématiques identifiés pour cet appel sont regroupées selon des "Transition Pathways" :
- La thématique sur les quartiers à énergie positive (PED) vise à développer des solutions innovantes pour la planification, la mise en œuvre à grande échelle et la reproduction des quartiers à énergie positive (PED) dans les zones urbaines et périurbaines en Europe.
- La thématique sur la ville du quart d’heure (15-minute City) vise à encourager les choix de mobilité durable, à redistribuer l’espace urbain et à réorganiser les activités pour rendre les villes plus neutres pour le climat et résilientes, accessibles à tous.
- La thématique sur les économies urbaines circulaires (CUE) vise à favoriser les lieux urbains, les communautés et les quartiers soutenus par des flux de ressources circulaires, tout en améliorant le bien-être de leurs habitants et de leurs écosystèmes. Elle encourage une planification et une conception urbaine fondées sur l’urbanisme régénératif, combinant les principes de l’économie circulaire, la végétalisation urbaine, et un accès équitable aux espaces et ressources urbains.
- 9 juillet 2025Pré-annonce : Appel à projets Transnational Conjoint Water4All 2025 « Eau et santé »Les agences de financement européennes et internationales de 31 pays lancent un appel à projets transnational pour financer des projets de recherche et d'innovation sur « Eau et santé ». Cet appel à projets transnational est lancé dans le cadre du partenariat européen Water4All et soutient des projets de recherche et d'innovation qui portent sur l’eau et la santé visant à relever des défis clés liés au lien entre l'eau et la santé humaine, y compris la qualité de l'eau, les contaminants et les technologies de traitement de l'eau. L'appel prend également en compte l'approche « One Health », reconnaissant les interconnexions entre la santé humaine, environnementale et animale. Conformément aux objectifs stratégiques de Water4All, les résultats des projets doivent contribuer à la mise en œuvre de politiques et stratégies de gestion de l'eau mondiales, européennes et nationales, dans le cadre du Green Deal, de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), de la Transition Juste, des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et de la Stratégie pour la résilience dans le domaine de l’eau. Les propositions devront tenir compte des cadres législatifs et stratégiques appropriés aux niveaux national et international Thématiques de recherche : Le contexte des sujets généraux de l'appel est décrit dans le thème IV (IV.I; IV.III) de l’Agenda stratégique de recherche et d'innovation (SRIA) de Water4All. Les propositions de recherche et d’innovation soumises dans le cadre de cet appel doivent aborder au moins l’un des sujets suivants :
- Thématique 1 : Contaminants transportés par l’eau et risques pour la santé : occurrence, comportement, interactions et vulnérabilité
- Thématique 2 : Outils et technologies innovants pour la surveillance de la qualité de l'eau et de l'exposition aux contaminants via l’eau
- Thématique 3 : Traitement de l'eau et atténuation de l'exposition aux contaminants via l’eau
- Thématique 4 : Gouvernance, innovation socio-économique et intégration des politiques pour l'eau et la santé
- 9 juillet 2025Lancement du LabCom AMIE : une alliance scientifique et industrielle pour des batteries tout-solide ITEN toujours plus performantes et éco-responsablesLyon, le 8 juillet 2025 – L'École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon), le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1, la société ITEN et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent le lancement du LabCom AMIE (Analyse des matériaux et interfaces pour l’énergie). Ce partenariat stratégique, soutenu par l’ANR à hauteur de 363 k€, et réunissant recherche académique et innovation industrielle, vise à repousser les limites en matière de performances techniques, écologiques et durabilité des batteries tout-solide ITEN.
- 8 juillet 2025France 2030 – Attractivité de la recherche française : 15 nouveaux chercheurs et chercheuses distingués dans le cadre des « Chaires d’excellence en Biologie / Santé »Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’accès aux soins, Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, et Charles-Edouard Escurat, directeur général de l’Agence de l’innovation en santé, annoncent le nom des 15 chercheurs et chercheuses distingués par une « Chaires d’excellence en Biologie/Santé » de France 2030. Leurs projets de recherche seront ainsi financés pour une durée de cinq ans. Ce dispositif, qui vise à renforcer l’attractivité de la recherche biomédicale française, soutient des scientifiques d’exception.
- 30 juin 2025Réalités virtuelles et augmentées : un laboratoire d’innovation technologique pour l’immersion multisensorielleLe laboratoire Perception, Représentations, Image Son Musique - PRISM (AMU/CNRS), la société Immersion et l’Agence nationale de la recherche (ANR) annoncent la création du LabCom LITIMS (Laboratoire d’Innovation Technologique pour l’Immersion Multi-Sensorielle), visant à l’implémentation d'une plateforme technologique pour le prototypage d'applications multisensorielles. Bénéficiant d’un financement de l’ANR de 363 k€ sur 54 mois, et d’un complément apporté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce partenariat ambitionne de se pérenniser grâce à la valorisation des avancées scientifiques et technologiques acquises sur la durée du projet.
- 27 juin 2025Appel à projets générique 2025 : l’ANR publie les premières listes de projets sélectionnésL’Agence nationale de la recherche (ANR) publie, au fil de la tenue des comités d’évaluation scientifique en juin et juillet 2025, les listes des projets de recherche sélectionnés à l’Appel à projets générique (AAPG) 2025, afin de les contractualiser au plus tôt.
- 27 juin 2025Le Hcéres publie le rapport d’évaluation de l’ANRLe Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) a rendu public le 27 juin le rapport d’évaluation concernant l’Agence nationale de la recherche (ANR). Cette évaluation a été conduite par un comité de 9 experts de 4 nationalités différentes présidé par Véronique Halloin, Secrétaire générale du Fonds de la recherche scientifique (Belgique).
- 27 juin 2025A Nice, l’ANR dresse son bilan de vingt ans de recherche pour l’océanDébut juin, Nice a accueilli deux grands rendez-vous internationaux autour de la préservation de l’océan : le One Ocean Science Congress (OOSC), réunissant plus de 2 000 scientifiques, et la 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3). Enjeux de gouvernance, de protection de la biodiversité marine, de lutte contre la pollution plastique ou encore de financement de la recherche : Anne-Hélène Prieur-Richard, responsable du département EERB (Environnements, Écosystèmes et Ressources Biologiques) de l’ANR, revient sur les temps forts de ces événements et sur le bilan de 20 ans de soutien à la recherche océanique à l’ANR.
- 27 juin 2025« Pêche et biodiversité dans l’Océan indien » (Bridges) : un programme de recherche pour penser et coconstruire des usages durables et équitables des ressources marinesLe programme de recherche exploratoire (PEPR) « Pêche et biodiversité dans l’océan Indien » (BRIDGES) concentre ses travaux sur les terrains du sud-ouest de l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, les Comores, le Mozambique et l’espace hauturier Canal du Mozambique et sud-ouest de l’océan Indien), des régions particulièrement concernées par les manifestations du changement climatique et les conflits d’usages liés à la pêche qui en découlent. A la croisée des sciences environnementales, des sciences humaines et sociales, de la diplomatie scientifique, BRIDGES vise à identifier et coconstruire des solutions garantissant la conservation de la biodiversité et une pêche juste et durable face au changement climatique et à une exploitation croissante des ressources marines. Des défis de taille pour ce programme, piloté par le CNRS, l’IFREMER et l’IRD, qui se déploiera sur dix ans grâce à un financement de 28 M€ de France 2030. Rencontre avec Emmanuelle Roque pour l’Ifremer et Joachim Claudet pour le CNRS, codirecteurs du programme, au côté de Frédéric Ménard pour l’IRD.
- 26 juin 20252e participation de l’ANR au festival TURFUDu 1er avril au 5 avril, l’ANR a participé pour la seconde fois au TURFU, festival dédié aux sciences, à l’innovation et aux recherches participatives porté depuis 9 ans par le Dôme, centre de culture scientifique et technique de Caen. 6 équipes lauréates de projets ANR SAPS (« Science avec et pour la société ») ont répondu à l’appel de cette édition qui a réuni 3 400 participants venus « interroger le présent et explorer les futurs possibles ».
- 25 juin 2025Belmont Forum - OCEAN 2 - Vers l'océan que nous voulons : biodiversité et durabilité des écosystèmes pour la nature et le bien-être humainCet appel est une contribution officielle à la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable. Les projets financés par cet appel seront considérés comme officiellement approuvés par les actions de la Décennie, ce qui facilitera l'engagement des équipes de recherche dans le réseau des partenaires et des initiatives de la Décennie de l'océan. Les propositions doivent intégrer des éléments d'au moins un des trois domaines énumérés ci-dessous :
- Conservation de la biodiversité et solutions basées sur la nature.
- Intégration océan-biodiversité-climat.
- Avenirs de la nature, gouvernance des océans et éthique de la durabilité.
- 23 juin 2025BiodivConnect - Restauration de la fonctionnalité, de l’intégrité et de la connectivité des écosystèmes - Biodiversa+ 2026L’appel BiodivConnect est lancé par le partenariat européen pour la biodiversité dans le cadre d’Horizon Europe – Biodiversa+. S’inscrivant dans le programme phare « Soutenir la protection et la restauration de la biodiversité sur terre comme en mer » Il contribuera à atteindre l’un des objectifs stratégiques du partenariat : produire des connaissances appliquées, pratiques et utilisables pour soutenir un changement transformateur visant à arrêter et inverser le déclin de la biodiversité (Agenda stratégique de Recherche et d’Innovation de Biodiversa+). Contexte et priorités de recherche BiodivConnect vise à soutenir une recherche innovante qui contribuera à atteindre et respecter les engagements relatifs à la biodiversité aux niveaux européen et mondial d’ici et au-delà 2030 (exemple : cadre mondial pour la biodiversité de Kumming-Montréal). Les résultats seront destinés à être intégrés aux pratiques de restauration de la nature. L’objectif est de favoriser des écosystèmes et des habitats interconnectés et écologiquement fonctionnels. Une attention particulière est portée à la durabilité et à l’adaptabilité des actions de restauration, ainsi qu’à l’évaluation de leur efficacité dans le temps et à différentes échelles spatiales (locales, régionales, transfrontalières, mondiales, etc.). L’appel couvre tous types d’écosystèmes et d’habitats, dans toutes les régions du monde. Il soutient des projets de recherche et d’innovation de grande qualité adoptant des approches holistiques, systémiques et intégrées. Les projets proposés pourront porter sur divers aspects tels que : différentes catégories d’indicateurs ; études multi-échelles et transposabilité des efforts de restauration ; prises en compte des dimensions écologiques, socio-économiques et socio-culturelles, et/ou des différents niveaux de réglementation et de politiques environnementales, harmonisation, etc. BiodivConnect s’organise autour de trois sujets principaux non mutuellement exclusifs et pouvant se recouper :
- Sujet 1 : Définir des objectifs de restauration (cohérents et opérationnels) et mesurer le succès… … en termes de fonctionnement, d’intégrité et de connectivité des écosystèmes. Les projets sont invités à prendre en compte les évolutions des références de base (shifting baselines) et à intégrer les dimensions écologiques, culturelles et sociales, en s’appuyant sur des approches tournées vers les objectifs.
- Sujet 2 : Transférabilité (significative) et généralisation (efficace) des efforts de restauration de la nature… … pour une meilleure compréhension des méthodes possibles et des opportunités dans des contextes aux enjeux socio-économiques et environnementaux variés.
- Sujet 3 : Résilience et durabilité des efforts de restauration… …à long terme pour les espèces, habitats et écosystèmes restaurés, notamment face au changement climatique et à d’autres perturbations.
- 18 juin 2025Belmont Forum - RESILIENCE : Gestion de la vulnérabilité et de la résilience des systèmes socio-environnementaux dans les territoires exposés - 2025S'inspirant de la récente crise pandémique de la COVID-19, cette nouvelle action de recherche collaborative (CRA), appelée Resilience, s'appuie notamment sur la précédente CRA intitulée Disaster Risk Reduction and Resilience (DR3, 2019) du Belmont Forum et vise à définir et à promouvoir de « nouveaux » concepts de gestion des risques qui tiennent mieux compte du changement global et de l'évolution rapide des relations entre les sociétés et la nature. Parmi les résultats attendus, citons le développement de la science des risques en accord avec la science de la durabilité, la co-production de connaissances, l'accent mis sur les territoires très vulnérables, la gouvernance informée et l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques et de parties prenantes capables de mieux faire face à des risques environnementaux en constante augmentation. Domaines d'intervention L'appel sollicitera des propositions portant sur au moins deux des domaines suivants :
- Domaine 1 : Mieux évaluer les risques dont la complexité augmente avec le changement global
- Domaine 2 : Accorder une attention particulière aux vulnérabilités exacerbées dans les territoires fortement exposés
- Domaine 3 : Développer des solutions innovantes pour la réduction des risques de catastrophes.
- 10 juin 2025Technologies quantiques : 5ème appel à projets QuantERACet appel à projets transnationaux, cofinancé par la commission européenne, est divisé en deux thématiques :
- Quantum Phenomena and Resources (QPR), qui vise à établir les principes fondamentaux des technologies quantiques du futur.
- Applied Quantum Science (AQS), dont l'objectif est d'utiliser les effets quantiques connus et les concepts établis des sciences quantiques, de les transposer en applications technologiques et de développer de nouveaux produits.
- 3 juin 2025Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense : appel thématique Résistance 2025L’actualité récente a permis au grand public de prendre connaissance de faits avérés de désinformation à grande échelle opérés par des puissances hostiles à la France. Ceci illustre concrètement les opérations d’influences étrangères malveillantes. Elles sont au cœur de menaces hybrides impactant, entre autres, le processus démocratique et l’économie dans un monde de moins en moins polarisé et de plus en plus en plus fracturé. C’est pourquoi, L’Agence nationale de la recherche et l’Agence de l’innovation de défense (AID) lancent un appel à projets ASTRID thématique sur le développement de solutions concourantes à la résistance des concitoyens à la désinformation. Par cet appel à projet, les Agences appellent la communauté académique à proposer des projets de recherche d’intérêt civil et défense qui permettront d’une part d’identifier des leviers dans la sphère privée ou publique concourants à l’augmentation de la résistance à la désinformation, d’autre part de définir les outils et méthodes nécessaires à l’activation de ces leviers, et enfin de construire les indicateurs permettant d’en mesurer les effets.
- 24 avril 20254ème appel à projets transnational 2025 du Partenariat européen Clean Energy Transition (CETP)Clean Energy Transition Partnership (CETP) est une initiative transnationale de programmation conjointe de la recherche, du développement technologique et de l'innovation qui vise à stimuler et accélérer la transition énergétique, en s'appuyant sur les acteurs régionaux et nationaux de financement de la recherche et de l'innovation (agences nationales, régions...). L’appel CETP 2025 s’articule autour de 10 modules thématiques d’appel (Call Modules, CM), chacun traitant d’un aspect clé de la transition énergétique. Ces modules sont eux-mêmes issus de 7 initiatives de transition (les Transition Initiatives – TRI), qui identifient les principaux défis à relever pour réussir à la transition vers une énergie propre. Pour l’appel CETP 2025, l’ANR participera à 7 modules thématiques, dont les suivants :
- CM2025-01 (TRI 1 & TRI 6) : Multi-vector interactions between the integrated energy system and industrial frameworks
- CM2025-02 (TRI 1 & TRI 2) : Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration
- CM2025-03A (TRI 2) : Advanced renewable energy (RE) technologies for power production (ROA)
- CM2025-04 (TRI 3) : Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)
- CM2025-05 (TRI 3) : Hydrogen & renewable fuels. Concernant la production d'hydrogène, seule la production d'hydrogène vert sera éligible à l'ANR.
- CM2025-06 (TRI 4) : Heating and cooling technologies. Seuls les projets de recherche appliquée et de développement (« Applied research and development projects ») - atteignant un niveau TRL 4, 5 ou 6 après l'achèvement du projet - seront éligibles à l'ANR.
- CM2025-09 (TRI 7) : Clean energy integration in the built environment
- 17 avril 2025Appel à projets de recherche Maladie de Charcot - SLA Cet appel à projet vise à réunir des scientifiques pour établir et développer une collaboration autour d’un projet de recherche interdisciplinaire commun, centré sur les besoins des patients atteints de la maladie de Charcot, en s’appuyant sur des expertises complémentaires. En vue d’une meilleure approche thérapeutique, le projet de recherche pourra couvrir un des champs de recherche suivants :
- Identification des éventuels signes précurseurs visibles avant l’apparition des troubles moteurs et/ou facteurs environnementaux, sociaux et comportementaux favorisant l’apparition de la maladie ;
- Recherche des causes de la maladie et compréhension des mécanismes physiopathologiques. Identification des déterminants moléculaires et cellulaires impliqués. Identification de nouveaux gènes et de leurs mutations ;
- Identification et caractérisation de biomarqueurs pour le diagnostic et le pronostic, qui pourront permettre de diagnostiquer plus tôt la maladie et découvrir des pistes pour ralentir sa progression ;
- Stratification des patients par la mise en place de mesures et de technologies pour caractériser les différents sous-groupes cliniques ;
- Développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.
- L’amélioration de la prise en charge médico-sociale et multidisciplinaire des patients avec la recherche/utilisation de dispositifs d’assistance pertinents pour maintenir leur qualité de vie ;
- L’association d’investigations sur les aspects éthiques et/ou médico-économiques des points d’étude cités ci-dessus ;
- L’identification de nouveaux critères d’évaluation cliniques afin d’améliorer les résultats de futurs essais cliniques.
- au minimum deux partenaires
- au moins un partenaire de type « organisme de recherche ou assimilés »
- 14 avril 2025France 2030 - PEPR "SVA : Sélection Végétale Avancée" - Appel à projets 2025Le programme SVA est structuré autour de quatre axes complémentaires. Il vise à maîtriser les techniques de l’édition des génomes sur un large panel d’espèces (Axe 1) tout en explorant son intégration dans les schémas de sélection, en complément d’autres outils d’aide à la sélection tel que la sélection génomique (Axe 3). Il entend évaluer, à travers des preuves de concept, le potentiel de l’édition des génomes pour contribuer aux objectifs de sélection adaptés aux systèmes agroécologiques dans un contexte de dérèglement climatique (Axe 2). Par ailleurs, le programme prévoit d’analyser et d’accompagner les processus d’innovation autour de l’édition des génomes en sélection végétale, en explorant les tensions et complémentarités avec les enjeux des transitions agroécologiques (Axe 4). Le programme SVA soutient financièrement des projets de recherche qui s’inscrivent dans ces objectifs scientifiques. Il finance quatre projets ciblés, ainsi que les projets de recherche qui seront sélectionnés via cet appel à projets. Les projets proposés doivent s’inscrire dans un ou plusieurs des quatre axes mentionnés ci-dessus et peuvent être complémentaires aux projets ciblés. Doté d’un montant de 7 M€, cet appel à projets financera des projets de recherche d’une durée maximale de 4 ans pour un montant d’aide minimal de 400k€ et maximal de 500 k€ par projet. Il est recommandé que la moitié de l’aide demandée soit dédiée au recrutement de post doctorants et doctorants. Les bénéficiaires des aides sont des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche, ou des groupements de ces établissements. Les entreprises et les établissements étrangers pourront avoir le statut d'Établissement partenaire dans les projets, mais ne bénéficieront pas de financement au titre de cette participation. L'appel à projets se déroulera en 2 phases. Dans une première phase, obligatoire et sélective, le porteur de projet déposera une lettre d’intention de 5 pages maximum, qui sera évaluée par un comité de pilotage, en association avec la présidence du comité international qui évaluera les propositions en phase 2. En effet, dans une seconde phase, les porteurs des lettres d’intention retenues en phase 1 seront appelés à déposer des projets complets, qui seront évalués par un comité international mandaté par l’ANR.
- 11 avril 2025France 2030 NMRC - Evaluation des nouveaux outils, nouveaux usages et nouvelles approches méthodologiques de recherche clinique – Appel à manifestation d’intérêtLe présent appel à manifestation vise à sélectionner des cas pilotes à même de répondre à l’objectif de démonstration de la valeur des nouveaux outils et nouvelles méthodologies de recherche clinique, en remplacement ou en complément des plans de développement classiques dans un but de diffusion de ces pratiques afin de contribuer à l’accélération des développements des technologies de santé innovantes. Les cas pilotes sélectionnés bénéficieront d’un suivi du GT Méthodologie co-piloté par l’AIS et F-CRIN. Ce suivi pourra se traduire, au cas par cas, par un suivi simple opérationnel, des recommandations d’experts sur le design, un appui règlementaire, un appui du Health Data Hub. Si une étude ancillaire s’avère nécessaire pour démontrer et mesurer la valeur du recours à ces approches, le cas pilote pourra bénéficier d’un financement au titre de France 2030 pour une durée de 18 à 24 mois et un montant de l’ordre de 250 k€. L’établissement coordinateur doit être une personne morale enregistrée en France et peut être un établissement de santé, un organisme de recherche ou un industriel promoteur d’étude (sauf en cas d’étude ancillaire financée au titre de France 2030). Les partenariats réunis sous forme de consortium et présentant une diversité de profils (promoteur, fournisseur de données, fournisseur de méthodologie, et/ou solution innovante, association de patients, professionnels de santé) sont fortement encouragés. La sélection en tant que « cas pilote » apportera, sans présager des résultats intrinsèques du projet, une reconnaissance de l’intérêt de sa démarche et de la capacité du promoteur et de ses partenaires à porter le projet et à contribuer à démontrer l’apport de nouvelles méthodologies. La sélection des cas pilotes dans le cadre de cet appel se déroulera en 2 étapes :
- 1ère phase : dépôt d’une lettre d’intention de 5 pages maximum présentant les objectifs et grandes lignes du projet ainsi que le consortium pressenti
- 2ème phase : les responsables des projets pré-sélectionnés lors de la 1ère phase seront invités à déposer un document complet (maximum 15 pages).
- 3 avril 2025Appel Afrique-Europe – "Services climatiques pour la réduction des risques en Afrique de l’Ouest" (CS4RRA) – 2026Les pays de l’Afrique de l’Ouest font face à l’urgence des enjeux climatiques, incluant la dégradation de l’environnement, la désertification, la variabilité des précipitations, les vagues de chaleurs, les inondations et la réduction de la productivité agricole. L’accélération des impacts du changement climatique, en plus de facteurs socio-économiques tels la croissance démographique et l’urbanisation, accentuent les défis climatiques. L’initiative “Services Climatiques pour la Réduction des Risques en Afrique de l’Ouest” (CS4RRA) lancée en 2023, est une action lancée conjointement par des pays européens en collaboration avec des institutions de l’Afrique de l’Ouest, dont ACMAD, AGRHYMET/ CILSS, WASCAL, les Centres africains d’Excellence et les agences de financement africaines. Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience climatique par les Savoirs, l’Innovation et le Renforcement des Capacités (SIRC), mobilisant les résultats des précédents programmes de l’Union Européenne (UE) et l’Union Africaine (UA) tels que (Horizon2020, Joint Programme Initiative Climate/SINCERE, Copernicus CCS). Thèmes Les propositions de recherche et d’innovation déposées dans le cadre de cet appel doivent porter sur une ou plusieurs des thématiques suivantes :
- Amélioration des Systèmes d’alerte précoce (Early Warning System) ;
- Amélioration de l’évaluation opérationnelle et de la prévention des risques sécuritaires liés au climat ;
- Amélioration des mécanismes de financement et de l’intégration institutionnelle des services climatiques.
- Répondre aux trois piliers de CS4RRA : Savoirs, Renforcement des Capacités et l'Innovation (SIRC) ;
- Suivre des approches inter- et transdisciplinaires encourageant la co-création d'activités entre les partenaires académiques et non-académiques (décideurs politiques, société et économie) ;
- Répondre aux besoins spécifiques liés au changement climatique exprimés par les parties prenantes d'Afrique de l'Ouest ;
- Associer la recherche et l'innovation (dont l’innovation sociale), faisant le lien entre l'excellence scientifique et l'impact social
- 27 mars 2025Soutien aux Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux - SRSEI 2025Le programme SRSEI a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant dans des laboratoires français ayant déposé en tant que coordinatrice/coordinateur un projet de recherche à des appels collaboratifs européens (Horizon Europe) ou internationaux de renforcer la qualité de leur candidature (proposition complète ou audition) pour la seconde étape de l’appel visé. Dans le cadre de cet appel, seules sont attendues des propositions ayant pour objet de renforcer un réseau scientifique européen ou international, coordonné par une équipe française ayant été invité à poursuivre sa candidature à la seconde étape d’un appel Européen ou international en plusieurs étapes. NB : Pour toute information ou orientation concernant les appels « Horizon Europe », veuillez contacter les PCN (Points de Contact Nationaux). Les propositions sélectionnées recevront une aide maximale de 17 k€ pour une durée de 12 mois. L’aide reçue financera exclusivement des actions permettant au réseau scientifique de se retrouver pour préparer la seconde étape de la candidature Européenne ou internationale (frais de mission, de réunion, de réception, etc…) et/ ou de la prestation de service pour aider la coordinatrice/ le coordinateur à finaliser le projet européen ou international. L'ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de décision et la mise en place des financements :
- un dossier de soumission simplifié ;
- un bénéficiaire unique de l'aide pour le compte du consortium complet : la tutelle gestionnaire de l’entité publique ou équivalente française ;
- une sélection simplifiée basée sur l’évaluation déjà réalisée par l’organisme de financement Européen/ international ;
- une procédure de décision de financement unilatérale
La Toul'Box

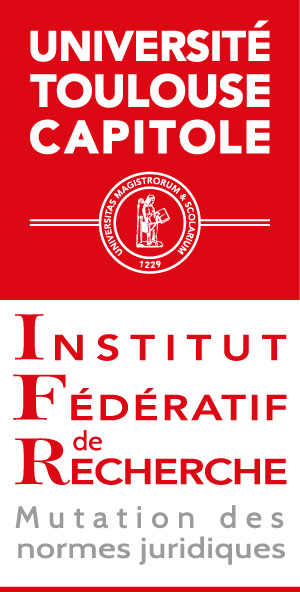





 Imprimer
Imprimer


